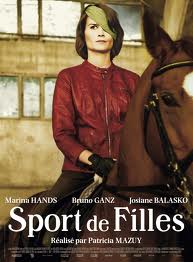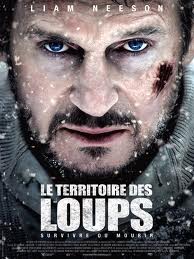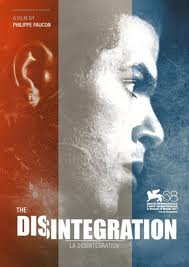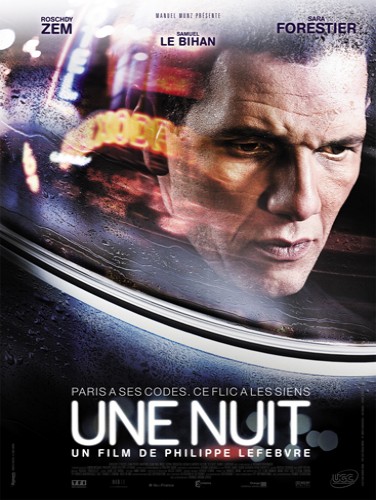1992: Danijel et Ajla dansent amoureusement dans une discothèque cible d’un attentat: l’explosion provoque un carnage. Leur visage couleur de sang forme l’affiche du film qui suggère aussi la profession de l’héroïne, artiste-peintre. 5 mois plus tard, Ajla est raflée parmi les femmes bosniaques de la cité, à destination d’un camp militaire serbe dirigé par le capitaine Danijel. A l’arrivée, l’otage qui se signale comme médecin est violée devant ses camarades. Un exemple du traitement inhumain qui les attend. De cet enfer, Danijel soustrait son amie en la transférant dans ses quartiers comme sa favorite, pour sauver une relation digne dans un milieu totalement déshumanisé et pour se préserver de la barbarie qui se répand. Il favorisera l’évasion d’Ajla avant d’être muté à Sarajevo et épargnera la vie d’un civil bosniaque, dans la ligne de mire de son fusil, au nom d’un même sentiment d’humanité. Triomphe de courte durée, sous l’influence révérencielle d’un père général, il va devoir se conformer aux siens et abandonner ses états d’âme sur l’autel de l’idéal combattant: tuer ses ennemis pour un gain politique.
Au pays du sang et du miel (la traduction étymologique inversée du mot turc «Balkans») égraine le chapelet douloureux et sanglant des exactions, sévices et violences subies par les populations civiles et les femmes pendant les quatre années de guerre en Bosnie. Viols et humiliations sexuelles, utilisation des civils comme boucliers humains lors des opérations de ratissage, déplacements forcés et massifs des populations, massacre de civils désarmés et meurtres d’enfants. Dans ce maelström politico-militaire d’une Bosnie-Herzégovine livrée au crime raciste, les acteurs agissent mécaniquement, leur identité perd toute densité et se dilue dans la peur et le sang. Angelina Jolie dénonce, sans faux fuyants ni voyeurisme déplacé, les actes de barbarie qui ont ensanglanté l’ex Yougoslavie sous le regard impuissant des soldats des nations unies et elle s’insurge des atermoiements occidentaux préoccupés de la protection des populations civiles mais incapables de trouver la solution politique qui en était la condition. Seuls les bombardements de l’Otan prenant position dans le conflit contraignirent les milices serbes à un cessez le feux puis aux accords de paix de décembre 1995. C’était à nos portes, à 40 minutes de la Riviera…